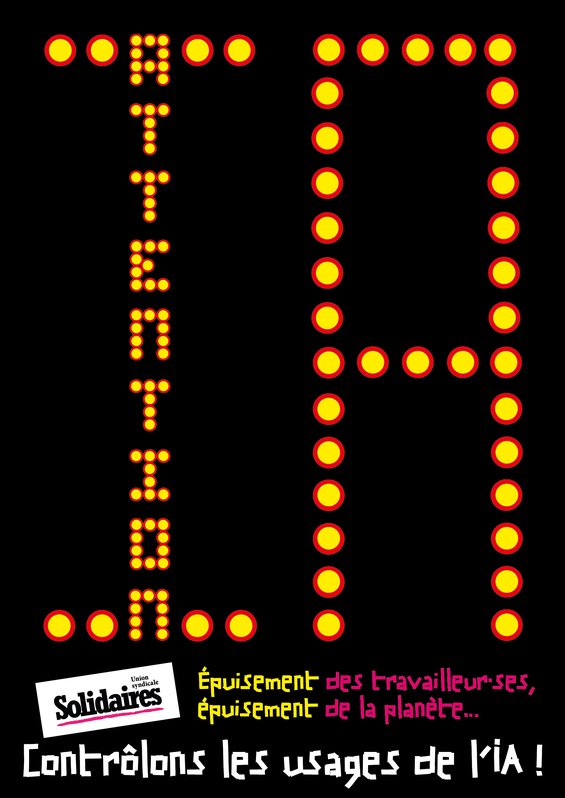L’intelligence artificielle (IA) percute de plein fouet notre vie quotidienne, mais aussi nos métiers et nos conditions de travail. À l’image d’une pensée magique, les gouvernements, les entreprises et les administrations en font le remède à tout et sont engagés dans une course folle pour son développement.
L’IA, c’est quoi ?
Loin d’être nouveau, le terme IA existe depuis les années 50. Cependant, dans le grand public, son usage s’est surtout popularisé récemment avec l’émergence des IA génératives, dont ChatGPT est l’exemple le plus connu.
Sans définition universelle qui fasse consensus, l’intelligence artificielle est décrite comme une discipline qui réunit science et technique afin de faire imiter par une machine les capacités cognitives humaines. Le Parlement européen définit l’intelligence artificielle comme tout outil utilisé par une machine capable de “reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité”.
Ces dernières années l’IA et plus largement les outils de science des données se sont très rapidement développés dans tous les domaines (moteur de recherche, enceintes connectées , GPS, appareil photo du smartphone…), le travail ne faisant pas exception.
L’IA est souvent présentée comme une avancée technologique ayant des conséquences positives (médecine…), cependant, dans les milieux professionnels, l’introduction de l’IA est davantage source de transformations des métiers sans que les travailleurs et travailleuses n’y soient jamais associé·es conduisant à une perte de sens du travail et à de nombreux licenciements. Elle reste à ce jour avant tout perçue comme un enjeu de croissance majeur par les multinationales et les gouvernements.
Les questions techniques et politiques que ça pose
Au-delà des promesses de progrès techniques et de transformation sociétale, les systèmes d’IA représentent des risques, notamment celui de véhiculer et exacerber des stéréotypes. Ils reflètent les préjugés existants, introduisent des biais, et renforcent les discriminations liées au genre, à l’orientation sexuelle, au handicap, à l’âge, la nationalité, la religion réelle ou supposée, mais aussi les discriminations racistes.
L’apprentissage automatique des IA produit fréquemment des absurdités, mais aussi des erreurs ou hallucinations.
Les données utilisées par les IA proviennent de contenus générés par des humain∙es, qui ne sont pas libres de droit ou qui sont des biens communs numériques comme Wikipedia. La même chose est valable pour les films, images, etc., qui sont pillés sans tenir compte du droit d’auteur.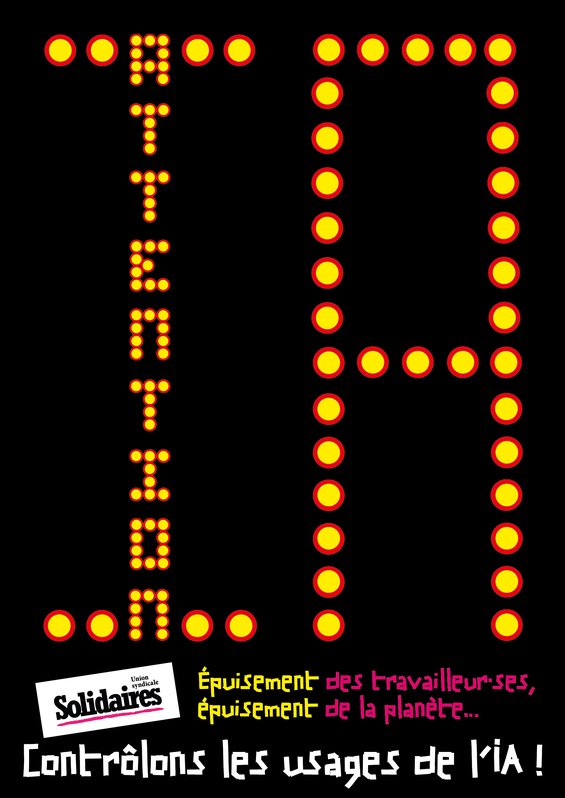
L’IA et ses conséquences sur le travail et l’emploi
Modernité, allègement des tâches, gains de temps, derrière les qualificatifs dithyrambiques des employeurs, ce sont souvent les employé·es qui trinquent. Le déploiement des outils de data-science s’accompagne de suppressions de postes : cela a été le cas dans la société Onclusive, spécialisée dans la veille média, mise en lumière par la lutte syndicale pour sauvegarder les emplois (160 salarié∙es licencié∙es sur un effectif initial de 383). Cela est aussi vrai dans la fonction publique, où l’obtention de fonds pour développer ces projets est conditionnée à des gains de productivité, comprenons des suppressions de postes.
Mais au-delà des suppressions de postes, c’est un véritable déplacement du travail, dans des -logiques néocoloniales, auquel nous assistons : les pays du Nord subissent des suppressions de postes et des restructurations, dans le même temps, les pays du Sud font travailler une main d’œuvre sous-payée, les travailleurs et travailleuses du clic, sous contrats à la tâche, chargé∙es d’entraîner les algorithmes, d’annoter et de corriger les données…
Dans les secteurs où des outils d’IA ont été mis en place, nous constatons :
- le renforcement d’oppressions comme le racisme ou le sexisme.
Dans les centres d’appels, les salarié∙es sont écouté∙es non seulement par leurs chef∙fes d’équipe, mais également par des IA qui peuvent les rappeler à l’ordre sur leur ton durant la conversation avec le ou la client·e (suffisamment jovial ou non), les mots utilisés, et leur accent. Plusieurs entreprises qui gèrent des centres d’appels ont aussi racheté des entreprises d’IA générative spécialisées pour changer le ton de la voix ou l’accent. En règle générale, en produisant les réponses les plus probables, les plus attendues, ou en cherchant à « standardiser » les voix et les accents, les IA reproduisent les discours dominants, à commencer par les stéréotypes racistes, sexistes, LGBTphobes, classistes, validistes… L’usage de l’IA dans le domaine professionnel engendre aussi des discriminiations immédiates, comme priver d’un emploi quand elle est utilisée pour le recrutement. - l’industrialisation de tâches déjà existantes privilégiant l’aspect quantitatif sur l’aspect qualitatif. Ainsi le logiciel de fabrication de planning de La Poste, Pop IA, confectionne des plannings à tour de bras mais sans tenir compte d’aucun paramètre humain comme la sécurité, la santé… simple fait
- la surveillance des salarié∙es et des usager∙es. Dans tous les services publics qui délivrent des prestations sociales (Caisses d’allocations familiales, France Travail…), les usager∙es les plus précaires sont ciblé∙es comme de potentiel∙les fraudeur·euses.Le simple fait d’être femme isolée , ou d’être attributare de l’Allocation adulte handicapée augmente le score de risque et la probabilité d’être contrôlé.
- une perte d’autonomie : aux finances publiques, les agent·es qui programmaient eux-mêmes les contrôles fiscaux en s’appuyant sur leurs connaissances se voient attribuer désormais des listes de sociétés soupçonnées de fraude sélectionnés par IA dans les services centraux ;
- une surcharge de travail liée au temps passé par l’intelligence humaine des salarié·es à réparer les erreurs de l’IA. Dans le métier de journaliste, les rédacteur·ices sont parfois relégué·es à un simple rôle de relecture ou de correction de textes générés par IA, sans initiative ni créativité, ce qui faisait pourtant le sel de leur métier ;
- la perte de sens au travail avec l’apparition de nouvelles opérations chronophages et dénuées d’intérêt, l’abandon de certaines tâches, des dépendances à l’outil informatique entraînant parfois la perte de savoirs professionnels et de technicités ou l’impossibilité d’expliquer le résultat trouvé par IA car développé en boîte noire. Un usage important des technologies numériques entraîne aussi un délestage cognitif avec des conséquences sur nos compétences et notre autonomie.
A qui profite l’IA ?
Dans le monde capitaliste où nous vivons, les systèmes d’IA reposent sur l’extraction massive de données personnelles pour augmenter les profits d’une poignée d’entreprises, parfois soutenues par des fonds publics. Les acteurs publics, les universités par exemple, n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour développer les modèles les plus avancés, détenir la puissance de calcul, posséder les data centers. Ce sont donc quelques géants de la tech (Meta, Google, Amazon, Alibaba, OpenAI, xAI d’Elon Musk…) qui se partagent le marché et imposent leur domination sans aucun débat démocratique. En utilisant l’IA, on fournit donc un travail gratuit pour entraîner les IA, et ainsi augmenter les profits de ces multinationales aussi puissantes que des États, et en collusion fréquente avec l’extrême droite.
L’IA : une grave menace pour l’environnement
Consommation en eau, énergie, métaux… l’IA accentue gravement l’impact du numérique sur l’environnement. Le coût écologique est colossal mais sous-évalué, en partie parce qu’il est complexe à mesurer, a fortiori lorsque les Big Tech ne jouent pas la transparence sur les données nécessaires aux calculs . En effet, il faut prendre en compte :
- tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’IA : data centers (centres de données) nécessaires au stockage et au traitement des données, réseaux, terminaux (smartphones, ordinateurs, tablettes) ;
- les envisager à chaque étape de leur cycle de vie : conception, fabrication, distribution, utilisation et gestion des déchets, sachant que la fabrication génère l’empreinte écologique la plus lourde, notamment parce qu’elle repose sur l’extraction minière.
- La construction de nombreux data centers peut impliquer l’artificialisation des sols. Ils sont de surcroît très voraces en énergie, qui au niveau mondial dépend aux deux tiers du charbon.
Quelques ordres de grandeur
- Une requête ChatGPT pourrait représenter au moins 10 fois la consommation électrique d’une recherche sur Google (qui n’est déjà pas neutre !).
- Une image générée par IA est l’équivalent électrique de la recharge d’un smartphone.
- D’ici 2030, les choix actuels de construction de data centers à l’échelle mondiale pourraient impliquer des émissions de gaz à effet de serre équivalents aux trois quarts des émissions de CO2 du secteur de l’aviation commerciale civile.
Une contribution croissante au dérèglement climatique
Pour rester dans la course à l’IA de nombreux pays et entreprises reculent sur leurs engagements en matière de neutralité carbone. Certains data centers, dont beaucoup aux États-Unis, ont annoncé recourir au gaz ou au charbon, impliquant de maintenir ouvertes des centrales dont la fermeture avait été annoncée. Google a augmenté de 65 % ses émissions de gaz à effet de serre en 5 ans, Microsoft de 29 % en 4 ans. Quand les entreprises prétendent décarboner la technologie, ce n’est pas mieux : des projets de data centers géants dotés de mini-centrales nucléaires pour les alimenter (Small modular reactors) se multiplient.
En fait, l’IA entraîne une fuite en avant climaticide en raison de ses effets directs (par la consommation d’énergie) et indirects : report des engagements climatiques justifiés par la course à l’IA et diffusion massive du climato-scepticisme par les IA elles-mêmes. Il est en effet très facile de générer du contenu vraisemblable, conspirationniste ou climato-sceptique, avec des IA. Cela augmente drastiquement la quantité de ces discours en circulation, dont se nourrissent ensuite d’autres IA qui captent leur contenu sur Internet.
Une technologie qui repose sur l’extractivisme
Les data centers nécessitent des systèmes de refroidissement importants, qui augmente encore la consommation d’énergie. Certains utilisent de grandes quantités d’eau également. Les data centers et les sources d’énergies utilisées pourraient consommer entre 4,2 et 6,6 milliards de m3 d’eau en 2027, soit une consommation légèrement supérieure à celle d’un pays comme le Danemark, sans compter l’eau utilisée pour fabriquer les composants.
Les ordinateurs, tablettes, smartphones, et plus encore les data centers consomment des quantités exponentielles de métaux. Pour répondre à la demande croissante d’ici à 2050, la quantité utilisée pourrait représenter 3 à 10 fois le volume produit actuellement. Or ces métaux sont extraits de mines dont les impacts pour la santé et l’environnement sont colossaux : expositions pour les travailleur·euses, surconsommation en eau dans des régions déjà touchées par les sécheresses, surconsommation d’énergie, production massive de déchets miniers très toxiques… Les mines sont des zones de sacrifice, que les gouvernement des pays du Nord imposent aux pays des Suds – dont ils accaparent les ressources – ainsi qu’aux territoires où le gouvernement mène une politique de renouveau minier en France.
Rendre des services d’IA entraînera de nouveaux “besoins” en ressources numériques : mémoire et stockage, capacités de traitement des ordinateurs et smartphones. Cela risque d’augmenter l’impact environnemental de ces objets, tant lors de leur production que de leur usage. Il faudra aussi les renouveler de façon anticipée pour pouvoir utiliser les IA. On peut prévoir le déploiement de nouveaux terminaux spécialement conçus pour l’IA, avec leurs propres effets environnement
Nos réponses syndicales pour freiner l’emballement autour de l’IA
Solidaires actif face aux directions :
Face au développement des projets d’IA dans nos secteurs professionnels, l’Union Solidaires et toutes ses structures sont aux côtés des salarié·es pour lutter contre le déploiement, imposé par les entreprises et les administrations, d’outils souvent peu respectueux des missions et des conditions de travail des personnels. Les dernières décisions juridictionnelles commencent à forger une jurisprudence obligeant les employeurs du privé à informer les syndicats de la mise en place d’un projet d’IA impactant les missions et les conditions de travail. Cette absence de consultation peut conduire le juge à demander le retrait de la technologie concernée. Dans la fonction publique, nous exigeons également le financement d’études d’impact d’IA sur les conditions de travail.
Nous revendiquons l’inscription de l’IA dans l’évaluation des risques professionnels et le financement d’études d’impacts, compte tenu de ses conséquences sur la santé des travailleur·euses.
Vous retrouverez sur les sites de Solidaires et de l’ensemble des structures du matériel détaillant l’arrivée d’IA dans les sphères professionnelles et leur impact sur le travail et notre vie quotidienne.
Solidaires combat les suppressions d’emplois
Les camarades de Solidaires Informatique se sont pleinement mobilisé∙es lorsque la société Onclusive fut l’une des premières à subir massivement des suppressions d’emplois du fait de l’arrivée de l’IA dans leur secteur professionnel. Dans la fonction publique, nous dénonçons les suppressions de postes conséquentes aux déploiement des outils d’IA. La défense de l’emploi et des travailleur·euses est centrale pour Solidaires.
Solidaires débat et s’organise !
Notre organisation syndicale a été l’une des premières à organiser un cycle de débats pour former aux dangers liés à l’arrivée de l’intelligence artificielle dans la sphère professionnelle, mais également sur ses dimensions liberticides, écocidaires et discriminatoires. Ces journées de débats ont mobilisé des camarades journalistes, informaticien·nes, postier·es, agent·es des finances publiques, traducteur·ices… Ils ont été enrichis par les contributions de sociologues, de membres de la Quadrature du Net, de juristes et de militant·es engagé·es contre les dérives d’une société entièrement numérisée. Par ailleurs, Solidaires organise régulièrement des espaces de débat dans ses locaux et sur sa chaîne Twitch, sur l’arrivée de l’IA.
Notre Union est engagée avec d’autres associations, collectifs ou syndicats dans la coalition Hiatus. Cette dernière entend résister au déploiement massif et généralisé de l’IA. Hiatus dénonce ainsi l’inféodation des politiques publiques aux intérêts de la tech, ainsi que les coûts humains et environnementaux de l’IA. Elle porte la revendication d’un moratoire sur les gros data centers.
Solidaires lutte contre l’opacité
Face au manque de transparence, nous mobilisons différents canaux pour obtenir de l’information et notamment tout ce qui a trait à la protection des données via le Règlement Général de la protection des données (AIPD (Analyse d’impacts à la protection des données), délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés, saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs…).
Lutter contre le déploiement capitaliste de ces outils ne se fera pas sans prise de conscience des enjeux de domination, de recherche du profit au mépris des conditions de travail, d’ultra-surveillance des populations, de la destruction environnementale et de réduction des libertés publiques. Aussi, et de toutes les façons possibles, y compris par la grève, notre union syndicale, aux côtés des salarié-es, des agents et des agentes continuera à se mobiliser.
 VISA 72 appelle à la mobilisation contre les violences sexistes et l’extrême droite VISA 72 lutte pour un monde du travail et une société où l’égalité entre toutes et tous est une réalité. Nous dénonçons les idées d’extrême droite, qui propagent la haine, la violence et les discriminations, et qui se banalisent chaque jour un peu plus. Pourquoi… afficher en ligne.
VISA 72 appelle à la mobilisation contre les violences sexistes et l’extrême droite VISA 72 lutte pour un monde du travail et une société où l’égalité entre toutes et tous est une réalité. Nous dénonçons les idées d’extrême droite, qui propagent la haine, la violence et les discriminations, et qui se banalisent chaque jour un peu plus. Pourquoi… afficher en ligne. Le 29 novembre, des nostalgiques du franquisme appellent à une« messe » dans une chapelle parisienne pour « se recueillir» àl’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Franco ;Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange fasciste, mort en1936, est associé à cet hommage.Pour les antifascistes et les démocrates de tous les pays, ce… afficher en ligne.
Le 29 novembre, des nostalgiques du franquisme appellent à une« messe » dans une chapelle parisienne pour « se recueillir» àl’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Franco ;Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange fasciste, mort en1936, est associé à cet hommage.Pour les antifascistes et les démocrates de tous les pays, ce… afficher en ligne. Depuis des années à Aix-Marseille université, les groupes étudiantsd’extrême-droite cherchent à s’implanter. Ils profitent des mesuresréactionnaires et anti-sociales du gouvernement pour gagner duterrain avec une confiance démesurée. Depuis la rentrée, ils ont agressé verbalement et physiquement, à plusieurs reprises, des étudiant-es, notamment de l’UnionÉtudiante et du Poing Levé. A AMU, deux groupes d’extrême-droite sont particulièrementprésents… afficher en ligne.
Depuis des années à Aix-Marseille université, les groupes étudiantsd’extrême-droite cherchent à s’implanter. Ils profitent des mesuresréactionnaires et anti-sociales du gouvernement pour gagner duterrain avec une confiance démesurée. Depuis la rentrée, ils ont agressé verbalement et physiquement, à plusieurs reprises, des étudiant-es, notamment de l’UnionÉtudiante et du Poing Levé. A AMU, deux groupes d’extrême-droite sont particulièrementprésents… afficher en ligne. 22 NOVEMBRE : un succès pour la mobilisation contre les violencesfaites aux femmes, aux filles et minorités de genre Les manifestations et les rassemblements organisés dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, filles et minorités de genre ont été un succès. Et les mobilisations ne sont pas… afficher en ligne.
22 NOVEMBRE : un succès pour la mobilisation contre les violencesfaites aux femmes, aux filles et minorités de genre Les manifestations et les rassemblements organisés dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, filles et minorités de genre ont été un succès. Et les mobilisations ne sont pas… afficher en ligne. Ces derniers mois et années, la situation politique s’est considérablement dégradée, que ce soit en France, en Europe et dans le monde, avec une extrême droite accédant au pouvoir ou sur le point d’y parvenir. Quand elle n’y est pas, ses idées sont banalisées, et préparent le terrain. En France, la constitution de l’empire médiatique… afficher en ligne.
Ces derniers mois et années, la situation politique s’est considérablement dégradée, que ce soit en France, en Europe et dans le monde, avec une extrême droite accédant au pouvoir ou sur le point d’y parvenir. Quand elle n’y est pas, ses idées sont banalisées, et préparent le terrain. En France, la constitution de l’empire médiatique… afficher en ligne. Lettre ouverte : à Monsieur Jean CastexPrésident Directeur Général du Groupe SNCFMonsieur Christophe FanichetPDG de la SA SNCF Voyageurs93 200 St DenisSt Denis, le 13 novembre 2025 Objet : Arrêt contrat cadre entre la SNCF et l’entreprise Smartbox du milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Stérin Messieurs, Nous avons appris récemment, à l’occasion d’un mail « adressé… afficher en ligne.
Lettre ouverte : à Monsieur Jean CastexPrésident Directeur Général du Groupe SNCFMonsieur Christophe FanichetPDG de la SA SNCF Voyageurs93 200 St DenisSt Denis, le 13 novembre 2025 Objet : Arrêt contrat cadre entre la SNCF et l’entreprise Smartbox du milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Stérin Messieurs, Nous avons appris récemment, à l’occasion d’un mail « adressé… afficher en ligne. SAMEDI 29 NOVEMBRE BOURSE DU TRAVAIL RUE DU CHATEAU D’EAU PARIS 4 tables rondes pour s’informer et echanger Participation au chapeau petite restauration sur place 9h30 Accueil café 10h-11h15 BANALISATION DU VOCABULAIRE ET DES THEMATIQUES D’EXTREME DROITE DANS LES MEDIAS avec Pauline Perrenot (Acrimed), Samuel Bouron (chercheur), Sébastien Fontenelle (journaliste à Blast) 11h30-12h45 : A… afficher en ligne.
SAMEDI 29 NOVEMBRE BOURSE DU TRAVAIL RUE DU CHATEAU D’EAU PARIS 4 tables rondes pour s’informer et echanger Participation au chapeau petite restauration sur place 9h30 Accueil café 10h-11h15 BANALISATION DU VOCABULAIRE ET DES THEMATIQUES D’EXTREME DROITE DANS LES MEDIAS avec Pauline Perrenot (Acrimed), Samuel Bouron (chercheur), Sébastien Fontenelle (journaliste à Blast) 11h30-12h45 : A… afficher en ligne. Faisons Front Face à la violence du Rassemblement NationalDepuis plus de 10 ans, notre section SUD CT à la mairie d’Hénin Beaumont livre un rude combat face à la municipalité RN. Face à nos camarades, Steeve BRIOIS, le maire et ami de M. LE PEN, multiplie les actes violents: pressions et attaques nominatives dans la… afficher en ligne.
Faisons Front Face à la violence du Rassemblement NationalDepuis plus de 10 ans, notre section SUD CT à la mairie d’Hénin Beaumont livre un rude combat face à la municipalité RN. Face à nos camarades, Steeve BRIOIS, le maire et ami de M. LE PEN, multiplie les actes violents: pressions et attaques nominatives dans la… afficher en ligne. Ce dimanche 16 novembre est prévue une représentation du spectacle La Dame de Pierre, à l’Arena d’Aix-en-Provence. Ce numéro pseudo-historique se veut être un hommage à Notre-Dame de Paris, qui se propose de « raconter l’histoire derrière la légende » et de « partir à la rencontre des bâtisseurs de cathédrale qui ont fait de Notre-Dame le symbole… afficher en ligne.
Ce dimanche 16 novembre est prévue une représentation du spectacle La Dame de Pierre, à l’Arena d’Aix-en-Provence. Ce numéro pseudo-historique se veut être un hommage à Notre-Dame de Paris, qui se propose de « raconter l’histoire derrière la légende » et de « partir à la rencontre des bâtisseurs de cathédrale qui ont fait de Notre-Dame le symbole… afficher en ligne. Un article intitulé « Sales Arabes » : deux élèves de seconde endurent des semaines de racisme avant que le lycée ne réagisse » publié par MEDIAPART le 12 octobre 2025 à 17h56fait état de propos, d’actes racistes au lycée agricole public de Luçon Pétré en Vendée. Le SNETAP-FSU des Pays de la Loire, première… afficher en ligne.
Un article intitulé « Sales Arabes » : deux élèves de seconde endurent des semaines de racisme avant que le lycée ne réagisse » publié par MEDIAPART le 12 octobre 2025 à 17h56fait état de propos, d’actes racistes au lycée agricole public de Luçon Pétré en Vendée. Le SNETAP-FSU des Pays de la Loire, première… afficher en ligne. Dans sa niche parlementaire le RN ambitionne de rétablir le délit de séjour irrégulier. C’est ce texte qui sera discuté en séance publique ce jeudi 30 octobre 2025. Celui-ci prévoit d’instaurer une amende de 3 750 euros à tout étranger âgé de plus de 18 ans qui séjourne en France sans titre de séjour. L’étranger… afficher en ligne.
Dans sa niche parlementaire le RN ambitionne de rétablir le délit de séjour irrégulier. C’est ce texte qui sera discuté en séance publique ce jeudi 30 octobre 2025. Celui-ci prévoit d’instaurer une amende de 3 750 euros à tout étranger âgé de plus de 18 ans qui séjourne en France sans titre de séjour. L’étranger… afficher en ligne. 05 novembre 2025 Bardella à Toulon ou le sous-marin des milliardairesqui veulent s’offrir la France… L’empire Bolloré attaque… l’élection présidentielle! En tournée commerciale, Jordan Bardella fait la promo de son deuxième livre « Ce que veulent les français», édité chez Fayard propriété de Bolloré (). Il prétend connaître leurs attentes, y compris celles des Français… afficher en ligne.
05 novembre 2025 Bardella à Toulon ou le sous-marin des milliardairesqui veulent s’offrir la France… L’empire Bolloré attaque… l’élection présidentielle! En tournée commerciale, Jordan Bardella fait la promo de son deuxième livre « Ce que veulent les français», édité chez Fayard propriété de Bolloré (). Il prétend connaître leurs attentes, y compris celles des Français… afficher en ligne. Municipales 2026 Lutter pour battre l’extrême-droite Stop aux mairies brunes Afin de lutter contre l’extrême-droite dans la perspective des municipales 2026, VISA publie une brochure au prix de 3 €. Elle vous sera envoyée dès fin novembre pour que vous puissiez la mettre à disposition de vos militant.es sur le terrain dès décembre. Concrètement, 2026… afficher en ligne.
Municipales 2026 Lutter pour battre l’extrême-droite Stop aux mairies brunes Afin de lutter contre l’extrême-droite dans la perspective des municipales 2026, VISA publie une brochure au prix de 3 €. Elle vous sera envoyée dès fin novembre pour que vous puissiez la mettre à disposition de vos militant.es sur le terrain dès décembre. Concrètement, 2026… afficher en ligne. Contre le patriarcat : ni oubli, ni silence,marchons contre les violences ! Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, nous manifesterons en solidarité, comme nous l’avons déjà fait le 11 octobre, avec et pour les femmes du monde entier : celles qui sont victimes des violences machistes,… afficher en ligne.
Contre le patriarcat : ni oubli, ni silence,marchons contre les violences ! Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, nous manifesterons en solidarité, comme nous l’avons déjà fait le 11 octobre, avec et pour les femmes du monde entier : celles qui sont victimes des violences machistes,… afficher en ligne. Dimanche 2 novembre, le café de la Grande Bourse accueillera M. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, dans le cadre d’une séance de dédicace de son livre Ce que veulent les Français. Après l’accueil des soutiens d’Éric Zemmour en 2022, ce sera donc la seconde fois que cette institution nîmoise bien connue déroule le tapis… afficher en ligne.
Dimanche 2 novembre, le café de la Grande Bourse accueillera M. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, dans le cadre d’une séance de dédicace de son livre Ce que veulent les Français. Après l’accueil des soutiens d’Éric Zemmour en 2022, ce sera donc la seconde fois que cette institution nîmoise bien connue déroule le tapis… afficher en ligne. L’union Départementale CGT 06 dénonce l’attaque à caractère fasciste, commise contre l’Union Locale CGT d’Antibes. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les dégradations découvertes ce samedi sur les murs de notre Union Locale CGT d’Antibes, où plusieurs croix gammées ont été tracées. Ces symboles de haine, directement hérités de l’idéologie nazie, constituent une provocation… afficher en ligne.
L’union Départementale CGT 06 dénonce l’attaque à caractère fasciste, commise contre l’Union Locale CGT d’Antibes. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les dégradations découvertes ce samedi sur les murs de notre Union Locale CGT d’Antibes, où plusieurs croix gammées ont été tracées. Ces symboles de haine, directement hérités de l’idéologie nazie, constituent une provocation… afficher en ligne. Lorient, le 26 octobre 2025 Samedi 25 octobre, 200 personnes se sont mobilisées dans un rassemblement populaire appelé par nombre d’organisations et collectifs afin de rappeler que les idées d’extrême droite ne doivent aucunement être banalisées et doivent être combattues partout. L’appel de la Digue, groupuscule nationaliste néonazi; à tendance néonazi, faisant l’apologie d’idées et… afficher en ligne.
Lorient, le 26 octobre 2025 Samedi 25 octobre, 200 personnes se sont mobilisées dans un rassemblement populaire appelé par nombre d’organisations et collectifs afin de rappeler que les idées d’extrême droite ne doivent aucunement être banalisées et doivent être combattues partout. L’appel de la Digue, groupuscule nationaliste néonazi; à tendance néonazi, faisant l’apologie d’idées et… afficher en ligne. 25 Novembre 2025 Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes Contre le patriarcat Ni oubli, ni silence Marchons contre les violences ! Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, nous manifesterons en solidarité, comme nous l’avons déjà fait le 11 octobre, avec et… afficher en ligne.
25 Novembre 2025 Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes Contre le patriarcat Ni oubli, ni silence Marchons contre les violences ! Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, nous manifesterons en solidarité, comme nous l’avons déjà fait le 11 octobre, avec et… afficher en ligne. Encore une fois, une Nuit du « Bien Commun » était prévue le 6 octobre au 6Mic à Aix-en-Provence, sous couvert de caritatif et de temps de philanthropie apolitique et solidaire. Il s’agissait en réalité d’un événement faisant partie d’un plan plus large porté par un milliardaire d’extrême-droite exilé fiscal en Belgique, Pierre- Édouard Stérin.… afficher en ligne.
Encore une fois, une Nuit du « Bien Commun » était prévue le 6 octobre au 6Mic à Aix-en-Provence, sous couvert de caritatif et de temps de philanthropie apolitique et solidaire. Il s’agissait en réalité d’un événement faisant partie d’un plan plus large porté par un milliardaire d’extrême-droite exilé fiscal en Belgique, Pierre- Édouard Stérin.… afficher en ligne. Après avoir mené une guerre politique contre la culture, le sport et la solidarité en supprimant des millions d’euros de subventions, le conseil régional des Pays de la Loire par la voie de sa présidente Christelle Morançais s’enferre dans des relations douteuses avec P-E Stérin. Après son soutien assumé à la nuit du bien commun… afficher en ligne.
Après avoir mené une guerre politique contre la culture, le sport et la solidarité en supprimant des millions d’euros de subventions, le conseil régional des Pays de la Loire par la voie de sa présidente Christelle Morançais s’enferre dans des relations douteuses avec P-E Stérin. Après son soutien assumé à la nuit du bien commun… afficher en ligne. Commnuiqué du SNJ-CGT Laure Lavalette, députée Rassemblement national (RN) de la 2e circonscription du Var, habituée des plateaux télévisés parisiens, a déménagé en début d’année de Toulon, ville qu’elle espère pourtantconquérir aux prochaines municipales. Elle s’est installée dans un village du département, mais elle refuse que ça se sache. La cible : un journaliste de… afficher en ligne.
Commnuiqué du SNJ-CGT Laure Lavalette, députée Rassemblement national (RN) de la 2e circonscription du Var, habituée des plateaux télévisés parisiens, a déménagé en début d’année de Toulon, ville qu’elle espère pourtantconquérir aux prochaines municipales. Elle s’est installée dans un village du département, mais elle refuse que ça se sache. La cible : un journaliste de… afficher en ligne. À cinq mois des élections municipales (premier et second tours les 15 et 22 mars 2026), les militants du Réseau pour la démocratie et contre les idées de l’extrême droite vont occuper le terrain. Réunis à Bierville (Essonne) les 29 et 30 septembre, ils ont redit leur détermination à porter un projet plus juste, plus solidaire et plus inclusif. Oui, l’extrême droite est raciste. Oui, l’extrême droite est misogyne. Oui,… afficher en ligne.
À cinq mois des élections municipales (premier et second tours les 15 et 22 mars 2026), les militants du Réseau pour la démocratie et contre les idées de l’extrême droite vont occuper le terrain. Réunis à Bierville (Essonne) les 29 et 30 septembre, ils ont redit leur détermination à porter un projet plus juste, plus solidaire et plus inclusif. Oui, l’extrême droite est raciste. Oui, l’extrême droite est misogyne. Oui,… afficher en ligne. Le Ministère de l’Instruction et du Mérite prépare une réforme des programmes scolaires. La première ministre d’extrême droite Giorgia Meloni, dès son arrivée à la tête de l’Etat en septembre 2022 grâce à une coalition de partis de droite et d’extrême droite, a pris des mesures idéologiquement très marquées. En rebaptisant le ministère de l’Education,… afficher en ligne.
Le Ministère de l’Instruction et du Mérite prépare une réforme des programmes scolaires. La première ministre d’extrême droite Giorgia Meloni, dès son arrivée à la tête de l’Etat en septembre 2022 grâce à une coalition de partis de droite et d’extrême droite, a pris des mesures idéologiquement très marquées. En rebaptisant le ministère de l’Education,… afficher en ligne. Vendredi 14 novembre de 19 h à 21 h Librairie Jean Jacques Rousseau à Chambéry. L’extrème droite progresse partout dans le monde : que faire ? quelles luttes syndicales s’y opposent ? VISA a documenté la montée des pouvoirs fascistes dans le monde et les chemins de résistances. afficher en ligne.
Vendredi 14 novembre de 19 h à 21 h Librairie Jean Jacques Rousseau à Chambéry. L’extrème droite progresse partout dans le monde : que faire ? quelles luttes syndicales s’y opposent ? VISA a documenté la montée des pouvoirs fascistes dans le monde et les chemins de résistances. afficher en ligne. Alors que l’austérité amenuise les budgets des régions, des départements, des mairies. Les services publics tombent les uns après les autres, les associations voient leurs subventions tenues en otage. L’extrême droite et les droites extrêmes instrumentalisent les régions, les départements et les communautés de communes pour diffuser et imposer leurs idées dans l’espace public. C’est… afficher en ligne.
Alors que l’austérité amenuise les budgets des régions, des départements, des mairies. Les services publics tombent les uns après les autres, les associations voient leurs subventions tenues en otage. L’extrême droite et les droites extrêmes instrumentalisent les régions, les départements et les communautés de communes pour diffuser et imposer leurs idées dans l’espace public. C’est… afficher en ligne. Fait à Aix-en-Provence, le 6 octobre 2025 Ce matin, lundi 6 octobre, 100% du « road crew » : nous, les 8 technicien·nes intermittent·es du spectacle employé·es à la journée pour assurer le déchargement et le montage technique de l’événement « la nuit du bien commun » au 6MIC, nous sommes mis·es en grève.Nous nous associons à l’ensemble des… afficher en ligne.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 octobre 2025 Ce matin, lundi 6 octobre, 100% du « road crew » : nous, les 8 technicien·nes intermittent·es du spectacle employé·es à la journée pour assurer le déchargement et le montage technique de l’événement « la nuit du bien commun » au 6MIC, nous sommes mis·es en grève.Nous nous associons à l’ensemble des… afficher en ligne. Fin septembre a eu lieu une campagne d’affichage du « Syndicat » de la Famille sur les panneaux de Saint-Brieuc, Dinan, Lamballe, Lannion et Paimpol. Héritier de la Manif pour Tous, ce prétendu « syndicat » est en réalité un groupe de pression issu des rangs les plus à droite des courants catholiques intégristes. Le Syndicat de la famille… afficher en ligne.
Fin septembre a eu lieu une campagne d’affichage du « Syndicat » de la Famille sur les panneaux de Saint-Brieuc, Dinan, Lamballe, Lannion et Paimpol. Héritier de la Manif pour Tous, ce prétendu « syndicat » est en réalité un groupe de pression issu des rangs les plus à droite des courants catholiques intégristes. Le Syndicat de la famille… afficher en ligne. Aujourd’hui les milliardaires de l’extrême droite française ne cachent plus leurs ambitions d’investir massivement dans le secteur culturel. Alors que Vincent Bolloré n’arrête pas d’élargir sa mainmise sur les médias, le livre, puis le cinéma avec le groupe Canal et ses visions sur UGC. Rappelons que dans les mairies d’extrême droite, comme à Béziers, Fréjus… afficher en ligne.
Aujourd’hui les milliardaires de l’extrême droite française ne cachent plus leurs ambitions d’investir massivement dans le secteur culturel. Alors que Vincent Bolloré n’arrête pas d’élargir sa mainmise sur les médias, le livre, puis le cinéma avec le groupe Canal et ses visions sur UGC. Rappelons que dans les mairies d’extrême droite, comme à Béziers, Fréjus… afficher en ligne. LE RN ET LA SÉCURITÉ SOCIALE Fin juillet, Achille Biziaux, conseiller Affaires Sociales du groupe RN à l’Assemblée Nationale envoie un courriel au réalisateur du film « La Sociale » Gilles Perret. Ce film retraçait avec brio l’histoire de la création de la Sécu après la deuxième guerre mondiale. Tout à sa tactique de dédiabolisation,… afficher en ligne.
LE RN ET LA SÉCURITÉ SOCIALE Fin juillet, Achille Biziaux, conseiller Affaires Sociales du groupe RN à l’Assemblée Nationale envoie un courriel au réalisateur du film « La Sociale » Gilles Perret. Ce film retraçait avec brio l’histoire de la création de la Sécu après la deuxième guerre mondiale. Tout à sa tactique de dédiabolisation,… afficher en ligne. Avec Estelle Delaine, maitresse de conférence en Scie,ce Politiques à l’Université de Rennes 2 20h30 le 8/10, Maison de Quartier de Villejean afficher en ligne.
Avec Estelle Delaine, maitresse de conférence en Scie,ce Politiques à l’Université de Rennes 2 20h30 le 8/10, Maison de Quartier de Villejean afficher en ligne. L’annonce dans la presse locale (La Nouvelle République, 20 septembre 2025) de la candidature d’une manager d’Inter Mutuelles Assistance (IMA) aux prochaines élections municipales à Niort, sous l’étiquette d’un parti politique classé à l’extrême droite par le Conseil d’Etat, suscite notre profonde indignation. IMA et toutes les mutuelles, historiquement ancrées dans l’économie sociale et solidaire,… afficher en ligne.
L’annonce dans la presse locale (La Nouvelle République, 20 septembre 2025) de la candidature d’une manager d’Inter Mutuelles Assistance (IMA) aux prochaines élections municipales à Niort, sous l’étiquette d’un parti politique classé à l’extrême droite par le Conseil d’Etat, suscite notre profonde indignation. IMA et toutes les mutuelles, historiquement ancrées dans l’économie sociale et solidaire,… afficher en ligne.